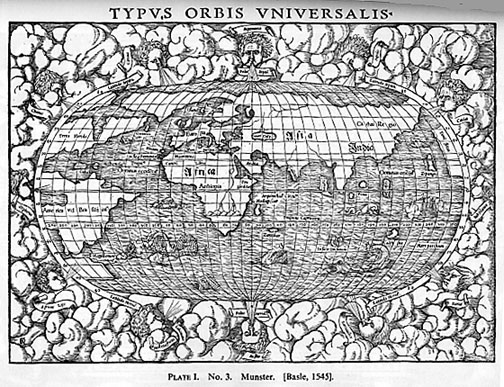
expédition polaire

Association Karukinka
Loi 1901 - d'intérêt général
Dernières nouvelles du bord
La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !
[Cap au Sud #10] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Première partie
Minuit. Cà y est, c’est Noël à Buenos Aires ! Pour le passage au 25 décembre, me voilà en route pour une croisière hauturière, dans un taxi direction un hôtel, depuis l’aéroport Ezeiza de Buenos Aires vers le centre de la capitale argentine, après un vol sans histoire...
Quel rôle joue le nouveau voilier de 20m dans la réalisation des activités de Karukinka ?
Un camp de base flottant polyvalent en Patagonie insulaire Milagro est un voilier d'expédition acquis par l'association Karukinka en 2023 grâce au soutien de ses membres. C'est un ketch Bruce Roberts de 20 mètres en acier qui joue un rôle fondamental dans la...
[Cap au Sud #9] de Salvador de Bahia (Brésil) à Buenos Aires (Argentine)
Récit d'Aude, équipière de Saint Nazaire à Ushuaia ! -Stage hauturier du Brésil à l'Argentine- Salvador, sûrement l’escale la plus en musique que nous ayons eu! L’arrivée de la transat était là! De Saint Nazaire à Salvador, quelques milles ont été parcourus et deux...
Le feu sous la glace : le volcan le plus isolé du monde abrite un lac de lave (National Geographic, 3 décembre 2024)
Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps qu’une île volcanique de l’Atlantique Sud renfermait un lac de lave. Pour l’étudier, ils ont dû s’aventurer dans l’un des lieux les plus reculés de la planète. Source :...
[Cap au Sud #6] Escale au Cap Vert
Mi-novembre, nous voici au mouillage dans la baie de Praia, la capitale de l'archipel du Cap Vert, pays indépendant depuis 1971. La descente vers le sud est déjà bien entamée puisque nous sommes désormais à la latitude de Dakar (Sénégal). L’arrivée s’est faite...
[Cap au Sud #5] Stage haute mer de Radazul (Tenerife, Canaries) à Praia (Cap Vert)
Nous ne vous parlerons pas du beurre qui était en rupture de stock à bord, >3kg ont été écoulés depuis St Nazaire et nous sommes passés à deux doigts d’aborder des navires que nous croisions sur la route pour récupérer une plaquette ! Nous sommes partis des...
[Cap au Sud #4] Stage haute mer de Vigo (Galice) à Radazul (Tenerife, Canaries)
Après le départ de Vigo nous traçons notre route direction les Canaries, et plus précisément l'île de Tenerife. Les prévisions de l'AEMET (agence météorologique espagnole) pour les zones qui nous concernent ces prochaines 48h sont : FINISTERRE : Ouest - Nord Ouest 5 à...
[Cap au Sud #3] Stage haute mer de La Corogne (Galice, Espagne) à… Vigo
Le lundi 21/10, nous quittons la Corogne. Peu de temps après avoir quitté la place du port, plus de sondeur, plus d’anémomètre et plus de pilote ! Un peu fâcheux pour naviguer… Après des tentatives de réparation pendant que le bateau sortait de la rade avec pas mal de...
[Cap au Sud #2] Stage haute mer de Saint Nazaire (Loire Atlantique, France) à La Corogne (Galice, Espagne) – traversée du Golfe de Gascogne
Nous sommes partis de bon matin mardi 15/10 pour une traversée plutôt « calme » du golfe de Gascogne; dégolfer est le terme technique. Les prévisions pour la zone IROISE - YEU nous promettent un vent d'Ouest à Sud-Ouest, 2 à 4 virant Est à Sud-Est 3 à 4, avant de...
[Cap au Sud #1] C’est partiii! Milagro, le voilier de l’association, a quitté la base sous marine de Saint Nazaire ! (14/10/2024)
Milagro quitte le bassin de la base sous marine de Saint Nazaire (14/10/2024) (c)Association Karukinka Le moment tant attendu a eu lieu, avec l'intensité des grands départs : avitaillement, derniers détails techniques et surtout les "au revoir" pleins d'émotion avec...




![[Cap au Sud #10] de Buenos Aires (Argentine) à Puerto Williams (Chili) Première partie](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/IMG-20250609-WA0015-400x250.jpg)

![[Cap au Sud #9] de Salvador de Bahia (Brésil) à Buenos Aires (Argentine)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20241208-WA0022-1-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #6] Escale au Cap Vert](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241120-WA0006-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #5] Stage haute mer de Radazul (Tenerife, Canaries) à Praia (Cap Vert)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/Spinnaker_Milagro-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #4] Stage haute mer de Vigo (Galice) à Radazul (Tenerife, Canaries)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241103-WA0031-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #3] Stage haute mer de La Corogne (Galice, Espagne) à… Vigo](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/RCN-Sada-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #2] Stage haute mer de Saint Nazaire (Loire Atlantique, France) à La Corogne (Galice, Espagne) – traversée du Golfe de Gascogne](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241103-WA0028-400x250.jpg)
![[Cap au Sud #1] C’est partiii! Milagro, le voilier de l’association, a quitté la base sous marine de Saint Nazaire ! (14/10/2024)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/10/Milagro_Saint-Nazaire_14102024-400x250.jpg)