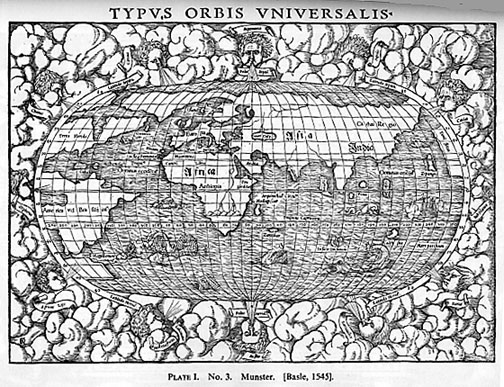
Chile

Association Karukinka
Loi 1901 - d'intérêt général
Dernières nouvelles du bord
La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !
La communauté Kawésqar Nómades del Mar participe à un atelier de plongée « pour la mémoire historique du territoire » (Journal UChile, 04/05/2025 “Comunidad Kawésqar Nómades del Mar participa de taller de buceo “por la memoria histórica del territorio”)
Dans une interview accordée à Radio et Diario Universidad de Chile, Leticia Caro partage les expériences qui ont marqué une nouvelle édition de cette initiative réalisée dans la région de Magallanes. « Expérimenter comme le faisaient nos anciens », réfléchit-elle....
Espaces Marins Côtiers pour les Peuples autochtones chiliens (ECMPO) (Subpesca.cl)
Il s'agit d'espaces marins délimités (ECMPO) dont l'administration est confiée à des communautés autochtones ou à des associations de celles-ci qui ont exercé un usage coutumier dudit espace tel que vérifié par la CONADI. Source (en espagnol):...
Chili : découverte exceptionnelle de plus de 100 espèces marines (Sciences & Vie, 26/02/2024)
Une expédition en haute mer au large des côtes chiliennes a récemment révélé des découvertes exceptionnelles, bouleversant notre compréhension de la biodiversité marine. Des chercheurs du Schmidt Ocean Institute (SOI) ont cartographié de vastes étendues...
Pont Radman : “C’est une oeuvre magnifique qui est liée au tourisme et au développement” (Gouvernement de Terre de Feu, 31/1/2024, “Puente Radman: “Es una obra magnífica que tiene que ver con el turismo y el desarrollo”)
Le gouverneur de la Terre de Feu AIAS (Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud), Gustavo Melella, accompagné de la présidente de la Direction provinciale des routes, Ileana Zarantonello, a visité les travaux achevés du pont Radman sur la rivière Rasmussen, sur la...
Nouvelle inauguration du musée le plus austral du monde, avec un nouveau nom et une nouvelle muséographie ( source: Service National du Patrimoine Culturel chilien, 10 janvier 2024)
Publié hier, l'article suivant témoigne d'une étape fondamentale pour la communauté yagan et le musée dédié à leur culture situé à Puerto Williams. Traduction de l'espagnol par l'association Karukinka Le Musée Anthropologique Martin Gusinde de Puerto Williams initie...
Le Chili intègre le peuple selk’nam à la liste des peuples indigènes reconnus par l’Etat (source: site internet de la chambre des députés chiliens, le 4 septembre 2023)
https://www.camara.cl/cms/noticias/2023/09/04/pueblo-selknam-es-incluido-entre-las-etnias-indigenas-reconocidas-por-el-estado/ Traduit de l'espagnol "L'assemblée a approuvé dans une troisième procédure un projet issus de députées et députés qui permet d'incorporer ce...
Des objets inconnus apparaissent dans la sépulture d’un enfant Selk’nam en Terre de Feu (Agencia SINC, 23/10/2019)
Dans la Bahía Inútil (Chili) une équipe de scientifiques a découvert une sépulture infantile appartenant à la culture Selk’nam, avec des caractéristiques uniques. Le trousseau qui l'accompagne présente des objets méconnus, ainsi que des objets funéraires inhabituels...






