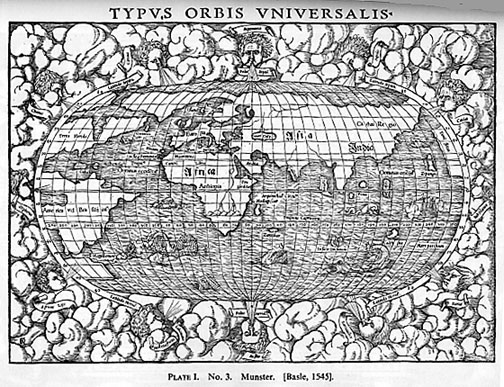
Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO)

Association Karukinka
Loi 1901 - d'intérêt général
Dernières nouvelles du bord
La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !
[UNOC3 peuples autochtones] Déclaration du réseau des «Femmes Autochtones» face à la Politique Océanique du Chili à la Conférence des Océans UNOC3 (Mapuche Diario, 19/06/2025)
Le Réseau des Femmes Autochtones pour la Défense de la Mer, composé de cinq peuples (Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar et Yagán) a dénoncé les attaques et l'invisibilisation subies au Chili malgré une loi reconnue internationalement comme un modèle de conservation...
Espaces Marins Côtiers pour les Peuples autochtones chiliens (ECMPO) (Subpesca.cl)
Il s'agit d'espaces marins délimités (ECMPO) dont l'administration est confiée à des communautés autochtones ou à des associations de celles-ci qui ont exercé un usage coutumier dudit espace tel que vérifié par la CONADI. Source (en espagnol):...
Chiliens et argentins ont prolongé la réclamation de protection du Beagle contre les élevages de saumons (InfoTDF, 5/7/2022, “Chilenos y argentinos extendieron el reclamo de protección del Beagle contra las salmoneras”)
Samedi dernier 2 juillet au matin, chiliens et argentins, navigateurs, kayakistes, activistes, référents d'organisations sociales et membres des communautés Yagán et Kawesqar se sont réunis au centre de la ville d'Ushuaia pour célébrer l'anniversaire de la sanction de...




![[UNOC3 peuples autochtones] Déclaration du réseau des «Femmes Autochtones» face à la Politique Océanique du Chili à la Conférence des Océans UNOC3 (Mapuche Diario, 19/06/2025)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/reseau-des-femmes-unoc3-peuples-autochtones-400x250.jpg)
