par Karukinka | Mar 6, 2020 | Non classé
https://www.geo.fr/aventure/vagues-vents-animaux-en-patagonie-elle-collecte-les-sons-dun-monde-oublie-198494
Ethno-acousticienne, Lauriane Lemasson se passionne pour les relations que tissent les peuples avec leur environnement sonore. Un métier qui la pousse à défier, micro en main, les rudes étendues de Patagonie. Avec un objectif : mieux comprendre les dynamiques de peuplement et les sources d’inspiration culturelles des Amérindiens qui occupaient ces confins avant d’être décimés.
Un pays de silence et d’espaces infinis. Dans cette pampa de la Patagonie argentine qui s’étale comme si elle ne devait jamais s’arrêter, les hommes sont rares et peu bavards. Inutile de demander sa route. Car, à part quelques moutons hirsutes qui semblent eux-mêmes se demander ce qu’ils fichent là, il n’y a plus âme pour répondre en ces lieux.
De toutes les façons, en deçà des 53° Sud, une fois passé le remuant détroit de Magellan, il n’existe guère qu’une seule vraie route terrestre sur ce gigantesque archipel qu’est la Terre de Feu : la Ruta n° 3, ruban couleur réglisse serpentant du nord au sud pour relier le bourg de Rio Grande au port d’Ushuaia. Pour le reste, cet antipode parmi les moins peuplés du cône sud-américain se résume à de vastes steppes tavelées de lacs sombres, des montagnes imprenables et des forêts jetées aux marges de l’océan.
Tout à pied
Et pour ne rien arranger, partout, des arbustes tarabiscotés, à demi-couchés, torturés par les bourrasques, des broussailles indémêlables, des lignes de barbelés rouillés et d’interminables barrières qui semblent se liguer pour fermer l’accès aux immenses estancias privées quadrillant encore la majeure partie de ce territoire. Voilà pour le décor : un vide aussi sidérant qu’hostile. Et pas de comité d’accueil.
C’est pourtant dans cette contrée compliquée que Lauriane Lemasson, 30 ans, a choisi de se perdre, seule, des mois durant, uniquement à pied et en dehors de la grande route balisée. Cette jeune bretonne au caractère bien trempé a enjambé les obstacles et les interdits histoire d’aller “là où personne ne va plus”, à l’exception des gauchos. Bref un vagabondage en bonne et due forme. Et en autonomie complète, harnachée d’un sac à dos de 25 kilos dans lequel Lauriane a fait entrer son réchaud à essence, des provisions lui permettant de tenir sans ravitaillement entre sept et dix-neuf jours selon la durée des déplacements, sa toile de tente, son duvet, son fidèle appareil photo Leica, ses carnets de notes, mais surtout une kyrielle de micros et d’instruments d’enregistrement.
Une boussole et une carte
Oubliant régulièrement de se chercher un abri pour le soir – “de toutes les façons, bien souvent, il n’y en avait pas”, se souvient-elle – notre marcheuse infatigable n’avait même pas de GPS lors de sa première échappée, juste une boussole et une bonne vieille carte au 750 000e. Objectif de ses sorties à la dure ? “Capter les sons des paysages patagons”, répond-elle très sérieusement. Drôle de quête, étrange programme.
Car ici, à part les rafales qui sifflent parfois à vous en rendre sourd, mutisme et contemplation sont de mise. “Très vite, on s’aperçoit que cet espace est habité par mille petits bruits qui esquissent bel et bien ces paysages sonores que je traque”, reconnaît Lauriane. De timides cris d’oiseaux, le grincement plaintif des arbres dans la tempête, le grognement des lions de mer, le craquement lointain des glaciers… Le moindre écho devient pour notre exploratrice une manière de compagnie.
Violence des éléments
“Lors de mon premier voyage à travers la Grande Ile de Terre de Feu, se souvient- elle, sur un total de trois mois et demi de pérégrination, je n’ai croisé, en dehors des zones urbaines, que trois personnes : deux estancieros, des employés des élevages qui n’en revenaient pas de voir une Française se balader seule dans les parages, et un vieil Argentin, un retraité avec qui je suis devenue amie. Aujourd’hui décédé, ce dernier vivait isolé et m’a accueillie chez lui sans hésitation un jour de très mauvais temps…”
Pluie, neige, tempête, grand soleil, chaleur harassante ou frimas remontant de l’Antarctique… Cette région a toujours affronté la violence des éléments et ses sortilèges. Avant sa découverte par l’Occident, lors de l’expédition de Magellan en 1512, sur les portulans médiévaux, on résumait d’ailleurs le coin en quelques indications incertaines : “brouillards”, “fin du monde”, “anti-terre”. Mais il en faut plus pour dérouter notre baroudeuse. Car Lauriane n’est pas qu’une aventurière. Et encore moins un genre de Don Quichotte au féminin, courant derrière d’impossibles moulins.Dans la baie de Tres Bazos, un des rares moments d’accalmie en trois mois d’expédition. Le soir même, la tempête fera rage. © Lauriane Lemasson
Une thèse en ethnomusicologie et acoustique
Doctorante à la Sorbonne, elle mène ses explorations sonores dans le cadre d’une très sérieuse thèse pluridisciplinaire en ethnomusicologie et acoustique. Un travail de recherche inédit qu’elle a entamé à partir de 2011 et qui s’appuie sur une intuition de départ qu’elle vérifie au fil de ses incursions en Terre de Feu : “Mes explorations entre Rio Grande et Ushuaia, dans la réserve provinciale Corazón de la Isla, près du lac Fagnano, ou encore sur le canal de Beagle et à travers la réserve de biosphère du cap Horn reposent sur une conviction. Les sons des lieux peuvent encore nous apprendre des choses sur les peuples amérindiens qui les ont occupés jadis. A condition d’écouter attentivement ce qu’ils ont à nous dire”, détaille-t-elle. De même que chaque recoin de la planète possède son odeur particulière, ses couleurs et ses températures, une ambiance tient aussi à l’acoustique.
«Chacun a pu en faire l’expérience, souligne la scientifique. Selon que vous soyez devant une montagne, dans une forêt, dans un désert ou au centre d’un théâtre antique, le paysage sonore influence la façon dont on occupe et perçoit un lieu. C’est cela que j’essaie de comprendre en y ajoutant le filtre de l’histoire, de la géographie et de l’anthropologie.» Partant de là, analyser la dimension acoustique d’un site archéologique, d’un ancien campement amérindien ou encore d’un sanctuaire dans lequel se déroulaient jadis des rituels chamaniques permet de mieux en expliquer le passé, voire de reconstituer une partie de l’environnement et de la culture de ceux qui y vécurent.
Micro en main, oreilles à l’affût
L’universitaire a parcouru plus de 2 000 kilomètres à pied. Avec pour simple Graal le souhait de réentendre la rumeur des premiers peuples fuégiens, ces autochtones patagons qui sont aujourd’hui de parfaits inconnus pour le grand public. «La plupart des livres et des articles à leur sujet affirment que ces Amérindiens arrivés en Terre de Feu il y a plus de 10 000 ans ont disparu depuis belle lurette, s’insurge Lauriane. Or, dès mon premier voyage, j’ai compris que la réalité était tout autre : des descendants de ces peuples indigènes exterminés par les colons européens ou assimilés de force à la culture hispanique sont encore bien vivants, que cela soit en Argentine ou au Chili. Pas plus que leur culture et leurs langues, menacées certes de disparition imminente à force d’être bafouées, n’ont été effacées des mémoires.»Ici , les vestiges d’une hutte cérémonielle. Les Selknams auraient choisi l’emplacement en fonction des propriétés acoustiques du lieu. © Lauriane Lemasson
A partir de ce constat, la quête de la jeune chercheuse prit un tour plus urgent encore. Soutenue dans ses recherches par l’ethnologue et explorateur arctique Jean Malaurie, figure mythique de l’aventure en terre extrême, Lauriane multiplia les prises de sons et les tests acoustiques. Elle débusqua, sur ce territoire désormais vidé de ses premiers occupants, des campements oubliés, ainsi que 2 500 emplacements de huttes. Elle reconstitua même les anciens toponymes, en langue amérindienne, de ces lieux qui n’avaient plus pour noms que ceux que leur avaient donnés les Espagnols. Tout ce travail de fourmi permet aujourd’hui à Lauriane d’avancer que dans ces sociétés ancestrales, entièrement tournées vers la nature, les chants chamaniques et les rites s’inspiraient principalement des sons émis par les animaux, les arbres, les vagues, les vents…
A la rencontre des Yagans
L’ethno-acousticienne est aussi partie à la rencontre des derniers locuteurs des langues yagan, haush ou selknam, en Argentine et au Chili. De quoi redonner vie à ce que racontaient au début du siècle dernier les rares anthropologues à s’être intéressés à ces indigènes. Tel le missionnaire Martin Gusinde qui, dans les années 1920, oublia vite sa mission évangélisatrice pour s’immerger avec passion dans le quotidien des tribus. En 2018, lors d’un nouveau voyage, c’est précisément vers les Yagans étudiés par Gusinde que Lauriane décida d’orienter ses recherches. Cap cette fois sur le canal de Beagle (Onashaga en langue yagan). A l’inverse des chasseurs-cueilleurs que furent les Selknams et les Haushs, les Yagans, eux, vivaient sur l’eau. Des nomades des canaux, se déplaçant sur de longues pirogues et se nourrissant surtout de la récolte de coquillages, lesquels étaient, selon les récits anciens, extraits des profondeurs glaciales par des femmes plongeuses quasi nues… Changement d’ambiance. L’expédition se déroule cette fois dans une Terre de Feu maritime, remuante et plus venteuse encore que les fois précédentes. L’Atlantique et le Pacifique s’y rencontrent frontalement, ce qui produit souvent des conditions météo dantesques.La région autour d’Ushuaia (Argentine) faisait partie du ter- ritoire yagan. Lauriane y réalise un enregistrement sur le site d’un ancien campement, identifiable grâce à des amas de coquillages. © Lauriane Lemasson
Un peu plus au sud du canal de Beagle se trouve le point de passage du cap Horn, réputé pour être la «patrie officielle du mal de mer»… Et puis, il y a ces fameuses caletas, des fjords aux côtes spongieuses et aux arbres couverts de longs cheveux de lichens, des replis creusés il y a des millénaires par les glaciers. Ces labyrinthes sinuent en allant vers l’ouest, après Ushuaia, puis le long de la façade pacifique de la Patagonie chilienne et jusqu’à l’archipel de Chiloé. «La navigation est le seul moyen si l’on veut accoster sur les îlots et les criques qui essaiment un peu partout, rappelle Lauriane. Mon idée première était de déambuler en canoë à la manière des Yagans, mais techniquement l’expédition était trop complexe et très risquée.» Elle s’embarque donc comme équipière sur un voilier avec une famille française, pour une croisière de trois mois. Approvisionnement et appareillage à Ushuaia, puis traversée des eaux frontalières hautement surveillées par l’armada chilienne pour une première escale dans le port le plus austral du monde : Puerto Williams, sur l’île chilienne de Navarino, un haut lieu de la culture yagan. De là, cap à l’ouest pour zigzaguer à travers les deux bras du Beagle et explorer les rives à pied afin d’y recenser les campements.
Pour ce périple, l’acousticienne a amélioré ces outils d’investigation sonore. Des micros capables d’enregistrer dans toutes les directions, des enregistreurs derniers cris, des protocoles millimétrés et… une simple boîte en bois ! Acheté dans une quincaillerie d’Ushuaia, l’objet est au format d’un carton de chaussures. En tapant sur son couvercle, comme sur un tambour, il produit un bruit sec et fort, lequel résonnera dans le vide. De quoi tester l’écho d’un lieu et analyser la circulation du son dans un site donné. Inspiré du protocole élaboré en 1967 par François Canac (un scientifique français ayant travaillé notamment sur l’acoustique des amphithéâtres romains), ce genre de test avec une boîte permet de mieux comprendre les sites occupés jadis par les premiers habitants.
Une découverte cruciale
Après avoir quitté le bateau, Lauriane est de retour dans les steppes pour deux mois encore de recherche solitaire. Puis, en avril dernier, lors de sa dernière expédition, c’est au centre de la Grande Ile de Terre de Feu qu’elle fait sa découverte la plus importante. Direction le site Ewan I, autrefois utilisé par les Selknams pour le rituel initiatique des jeunes adultes dit du Hain. Etudié par le laboratoire d’anthropologie et d’archéologie du Cadic (Centre austral d’investigations scientifiques d’Ushuaia), le lieu abrite une hutte cérémonielle toujours sur pied et datée de 1905. «Là, raconte Lauriane, j’ai pu procéder à des tests acoustiques pour comprendre l’emplacement de cette hutte. Situé en lisière d’une ancienne clairière, Ewan I fonctionne en effet comme un amphithéâtre où les sons (chants, paroles, cris) sont absorbés, conduits ou déviés par le relief. Il est probable que ces effets ne relevaient pas d’un hasard mais étaient considérés dans le choix du lieu du rituel pour en assurer le bon déroulement.» De quoi éclairer d’un jour nouveau la thèse universitaire de l’acousticienne. «On pourra demain expliquer d’autres lieux sacrés en analysant la façon dont ils résonnent», s’enthousiasme t-elle en pensant déjà à son prochain voyage. Il sera pour bientôt, et peut-être à bord de son propre petit voilier. «Je rêve de traverser l’Atlantique», souffle notre Bretonne. Avant de mettre, à nouveau, le cap au sud. Vers ce pays fuégien qui a encore tant de nuances sonores à lui murmurer.
➤ Pour jeter une oreille aux sons récoltés par Lauriane, rendez-vous dans la vidéo ci-dessus.
➤ Plus d’infos sur son site internet et sa page Facebook.
➤ Elle collecte les sons d’un monde oublié, reportage complet à découvrir dans le magazine GEO Aventure d’octobre-décembre 2019 (Vive la vie en van !)





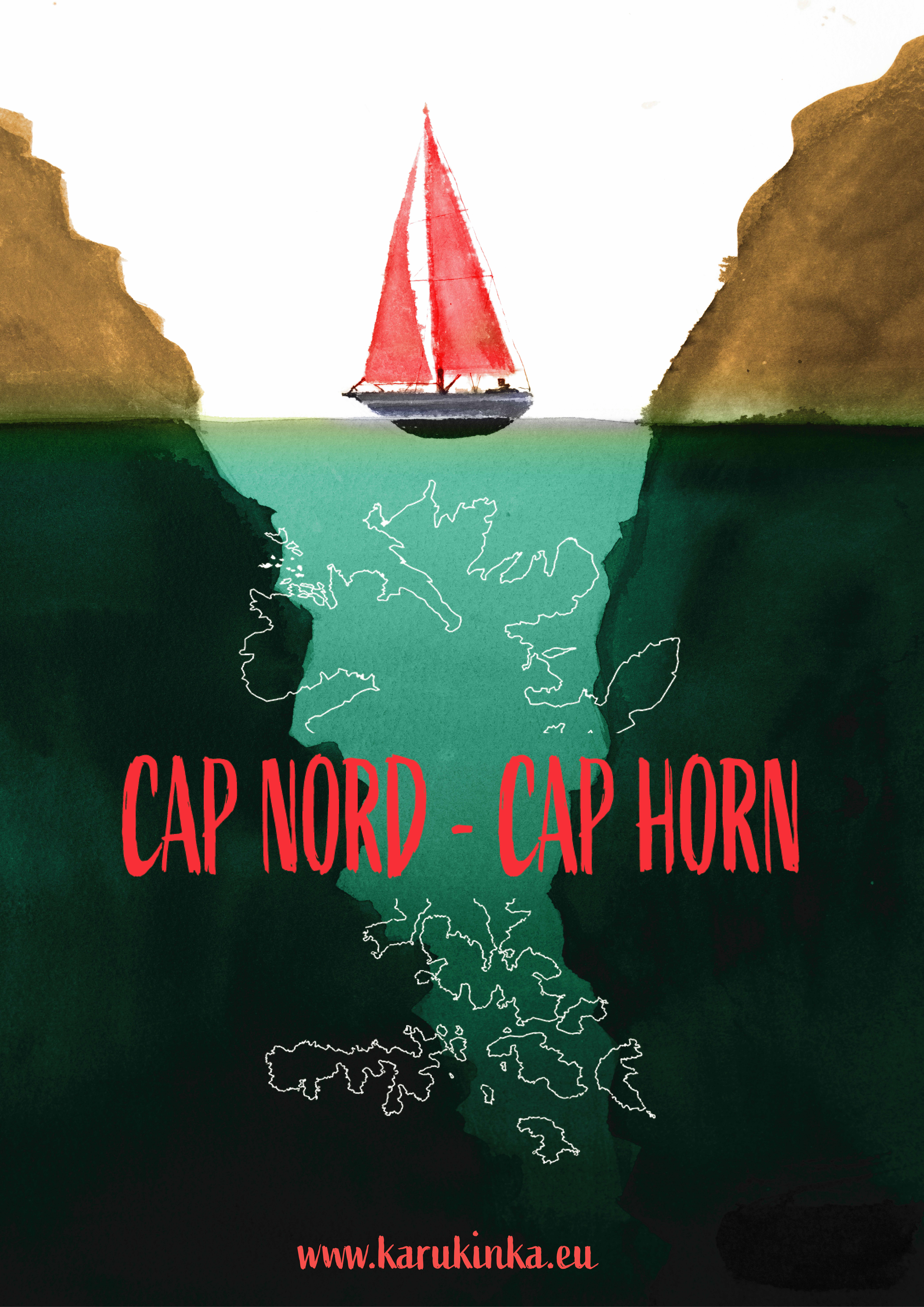



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/NTONHO7WFZCLXMJWYNDPBE6JCM.jpg)
:quality(70):focal(1507x1282:1517x1292)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/5AQHBWP7WBAMHG3BGZC7ITHEF4.JPG)