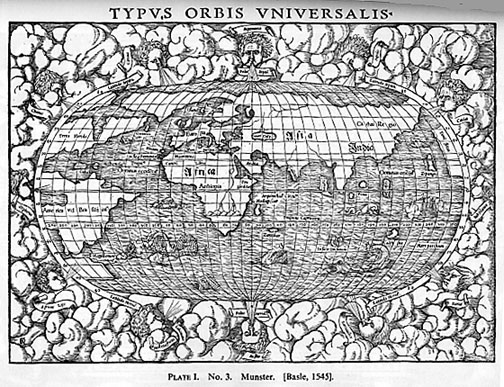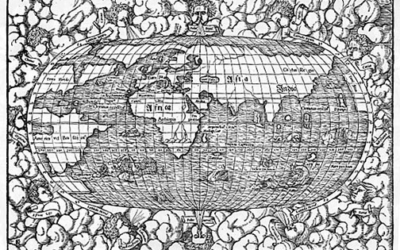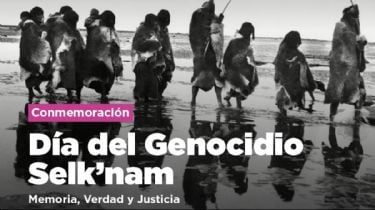Association Karukinka
Loi 1901 - d'intérêt général
Derniers articles

Suivez nous
Rafaela Ishton demeure l’une des figures les plus importantes et emblématiques de la résistance culturelle et de la mémoire Selk’nam de Terre de Feu. Fille de Felipe Ishton et de Petronila Tial, tous deux Selk’nam ayant vécu selon les habitudes ancestrales de leur peuple, elle incarne la dignité, la résilience et la transmission d’une identité qui a bravé l’extermination, l’exil puis la marginalisation au XXe siècle.
Son nom reste aujourd’hui associé à la communauté autochtone Selk’nam d’Argentine (Comunidad Indígena Selk’nam Rafaela Ishton), en hommage à son combat pour la mémoire et les droits des peuples indigènes Selkn’am et Haush.
Table des matières
Son enfance sur la Grande Île de Terre de Feu
Née le 1er août 1919 à l’estancia La Herminita, Rafaela baigne dès l’enfance dans la culture et la langue maternelle de son peuple. À l’âge de 5 ans, elle perd sa mère et est prise en charge par la Mission salésienne, institution catholique à la fois refuge, lieu de maltraitances et vecteur d’acculturation. Jusqu’à ses 20 ans, elle y mène sa jeunesse, subissant de plein fouet la disparition progressive des modes de vie traditionnels, alors que son peuple est violemment confronté aux bouleversements coloniaux.
La disparition accélérée du mode de vie ancestral Selk’nam — décimations, spoliations, migration — façonne sa jeunesse. C’est aussi dans ces années qu’elle apprend à naviguer entre plusieurs univers : autochtone, missionnaire, rural et ouvrier.
Une résistance silencieuse et en famille
Rafaela Ishton traverse une époque où la négation identitaire et la dépossession foncière sont la règle. Après les massacres et la réduction massive de la population au début du XXe siècle, les Selk’nam sont souvent réduits à l’exil répété, à la précarité et à une invisibilité sociale entretenue. L’intégration forcée dans l’économie des estancias (travail rural, domestique, pêche) contraste avec la mémoire d’une existence nomade et autonome.
En décembre 1940, elle épouse Santiago Rupatini et le couple part s’installer sur les rives du lac Khami (Fagnano), à l’estancia La Pampa, pour élever du bétail et tenter de maintenir une économie familiale dans un espace autrefois saisi aux Selk’nam. Rafaela travaille également comme cuisinière dans différentes estancias de la région, à Sara et San Sebastián, témoignage du rôle économique occupé par de nombreux survivants et descendants de survivants dans la nouvelle société de Terre de Feu en mutation.

La famille finit par s’installer à Ushuaia, capitale provinciale. Rafaela s’y emploie à la municipalité et élève ses cinq enfants : Juan Carlos, María Esther, Amalia, Carlos Armando et Aldo Domingo. Elle laisse aussi une importante postérité, de nombreux petits-enfants et descendants, portant aujourd’hui la fierté Selk’nam dans l’espace public.
Figure de mémoire et de la renaissance d’une communauté
Rafaela Ishton décède à l’âge de 66 ans, en 1985, à Ushuaia. Elle laisse derrière elle un héritage qui devient rapidement référence pour les descendants Selk’nam et symbole de l’engagement pour la mémoire autochtone. Son prénom est choisi par les siens pour nommer la « Communauté indigène Rafaela Ishton », reconnue en 1996 par l’Institut National des Affaires Indigènes d’Argentine, première entité Selk’nam officiellement enregistrée dans le pays. C’est également une référence pour toute la mouvance indigène du Sud austral (y compris les Haush et les Yagan).
La communauté impulsera des actions en faveur de la restitution foncière, de la revitalisation des pratiques culturelles, de la consultation auprès des pouvoirs publics, et demeure aujourd’hui l’interlocutrice principale pour la défense de la mémoire et des droits Selk’nam en Argentine.
La « Communauté indigène Rafaela Ishton » est à l’origine de nombreuses mobilisations. Son territoire communautaire à Tolhuin a reçu la première reconnaissance foncière autochtone argentine en 2014, sur la rive est du Lac Khami (Fagnano), un acte historique pour les peuples indigènes d’Argentine. Elle œuvre aujourd’hui dans l’inclusion des droits autochtones dans l’état civil (actes de naissance intégrant l’appartenance indigène), la participation à la gestion des forêts et du territoire, et la perpétuation de la mémoire orale de la culture Selk’nam.
Rafaela Ishton reste ainsi un symbole vivant, honoré dans les discours et la pratique, autour de l’idée de résistance, de dignité, mais aussi de vie au quotidien et d’ancrage sur la terre ancestrale. Sa trajectoire individuelle illustre la lutte pour la transmission identitaire et la résistance pacifique d’un peuple déclaré disparu mais qui n’a pourtant jamais cessé d’être vivant.