
Mapuches

Association Karukinka
Loi 1901 - d'intérêt général
Dernières nouvelles du bord
La Patagonie vous fait rêver ? Rejoignez l’aventure !
Le dialogue entre une machi et des écologues ouvre de nouvelles voies pour intégrer le savoir mapuche dans la conservation de la nature
L'étude propose un modèle de collaboration entre le savoir mapuche et la science écologique, démontrant que la conservation de la nature exige d'écouter, de respecter et de travailler aux côtés des communautés autochtones. Temuco, 23 octobre 2025. (diariomapuche.cl) –...
[UNOC3 peuples autochtones] Déclaration du réseau des «Femmes Autochtones» face à la Politique Océanique du Chili à la Conférence des Océans UNOC3 (Mapuche Diario, 19/06/2025)
Le Réseau des Femmes Autochtones pour la Défense de la Mer, composé de cinq peuples (Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar et Yagán) a dénoncé les attaques et l'invisibilisation subies au Chili malgré une loi reconnue internationalement comme un modèle de conservation...
Génocide Mapuche ou Pacification de l’Araucanie ? (01/06/2025, article et podcast Conociendo.cl)
La Pacification de l’Araucanie : analyse exhaustive de l’invasion, de la dépossession et du génocide Mapuche L’histoire du Chili comporte un chapitre écrit avec des euphémismes et du sang : la mal nommée « Pacification de l’Araucanie ». Cet article plonge dans les...
Alors qu’en Argentine les droits des peuples autochtones se perdent, au Chili, la co-gouvernance mapuche est accordée dans un parc national (18/12/2024 par Kay Pacha / Equipe Pueblos Originarios du SERPAJ, “Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional”)
Mapuches Chili Parc National Villarica
Une autre attaque sournoise contre les peuples autochtones, la loi 26160 a été abrogée (14/12/2024, par Kay Pacha / Equipe Pueblos Originarios du SERPAJ “Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160”)
Comme cela menaçait, a finalement été abrogée - par le décret 1083 - cette loi adoptée fin 2006 et qui avait été prolongée à plusieurs reprises. Bien qu’elle ait été considérée comme « d’urgence », sa prolongation a été de plus de 15 ans. #peuples autochtones...
Un mépris implacable : l’offensive de Milei contre les droits indigènes (12/06/2024, Alexia Campos, ANRed)
Marche du Contrafestejo, 12 octobre 2024. Photo : Nicolás Parodi / Page 12 Le gouvernement entend éliminer l'urgence territoriale autochtone qui suspend les expulsions et promeut des projets de consultation des communautés autochtones et de droit de la propriété qui...
Des progrès sont réalisés dans le procès du génocide de la « Conquête du désert » (21/11/2024, CTA Autonoma)
Le juge fédéral Rafecas estime que le procès pour la vérité initié par Lamngen Ivana Huenelaf contre la politique d'extermination impliquée par la campagne "Conquête du désert" doit être traité devant la Justice Fédérale de Neuquén. Source :...
Peuples racines : « 5 à 6 % de l’humanité préserve 80 % de la biodiversité de la planète » (We Planet, 06/06/2024)
À l’occasion du Green Shift Festival, qui se tient du 5 au 7 juin à Monaco, Jorge Quilaqueo, chamane Mapuche, a échangé avec Sabah Rahmani, journaliste anthropologue, et Hélène Collongues, anthropologue spécialiste du peuple Jivaro....
“Zahori”, passage à l’adolescence dans la steppe patagonienne (7 décembre 2021, RTS)
L'invitée: Marì Alessandrini, "Zahorì" / Vertigo / 13 min. / le 1 décembre 2021 "Zahori", tourné dans la steppe, raconte l’amitié inattendue entre une jeune fille de 13 ans originaire du Tessin et un vieil indien Mapuche. C'est le premier film de Mari Alessandrini,...
La réalité complexe des langues autochtones d’Argentine (DICYT, 08/05/2019)
Des chercheuses en sciences sociales du CONICET partagent leurs études culturelles et leurs expériences liées aux langues des peuples autochtones d'Argentine. Les langues autochtones d'Argentine CONICET/DICYT Cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho… Un...
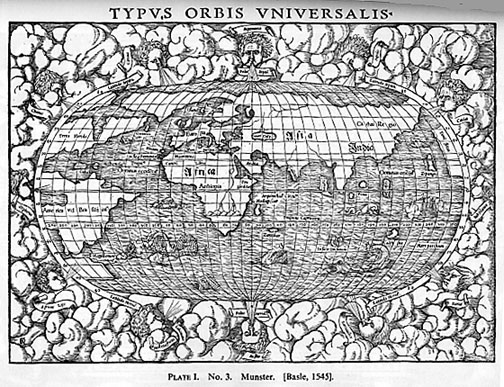




![[UNOC3 peuples autochtones] Déclaration du réseau des «Femmes Autochtones» face à la Politique Océanique du Chili à la Conférence des Océans UNOC3 (Mapuche Diario, 19/06/2025)](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2025/06/reseau-des-femmes-unoc3-peuples-autochtones-400x250.jpg)



